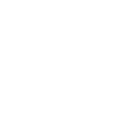on valide, on valide... c'est vite dit

Déjà il faut voir que dans les générations étudiantes, quelques années de différence n'ont l'air de rien mais sont très importantes dans la socialisation générale, et la socialisation politique en particulier.
Parmi les étudiants les plus âgés (et donc qui ont des caractéristiques particulières liées à l'avancement de leurs études), beaucoup sont passés par les mobilisations contre la guerre d'Algérie par exemple (en tant que lycéens, ou par proximité familiale s'ils avaient des parents investis politiquement etc). D'autres ont été politisés à partir de la contestation contre la guerre au Viet-Nam. D'autres sont entrés en politique au moment des crises dans les mouvements de gauche, et plus particulièrement des mouvements de jeunes ("révolution" dans l'UEC, etc). La plupart des militants ont connu en réalité plusieurs de ces déterminations contextuelles.
On a donc toute une frange bien politisée, et pas mal politisée aux marges de la politique partisane institutionnalisée (le reste étatn surtout chez la Jeunesse Communiste (PCF) à l'influence trop souvent négligée). [et je ne te suis pas du tout sur l'aspect apolitique de la politisation non institutionnalisée]
Le gros des troupes, comme dans tout mouvement social, nous semble insondable : les non militants laissent rarement des traces. Ca ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas du tout politisés, mais leur politisation était sans doute moindre, et moins organisée.
Pour l'invocation de Bourdieu, il faudrait être beaucoup plus fin que ça : le capital culturel emmagasiné par une grande partie des étudiants a cela de particulier qu'il semble subjectivement déconnecté d'une assurance matérielle économique à la fois dans le présent du parcours universitaire (thème de la misère du milieu étudiant), et dans le futur des opportunités d'emploi qui semblent bouchées pour une bonne partie des étudiants en sciences humaines et lettres. Ce capital, lorsqu'il est acquis par des jeunes issus de milieux populaires ou de classes moyennes basses, n'est surtout pas encore validé par une reconnaissance extérieure au milieu universitaire : les parents sont certainement fiers des études de leurs enfants, mais ils ne peuvent pas être ceux qui valident la nouvelle identité acquise, les diplômes semblent se dévaloriser à grand train, etc etc etc.
On a à faire en partie à une population d'individus "déclassés" ou "en cours de déclassement" (ne pas y lire quelque chose de négatif malgré le suffixe "dé-" : il s'agit ici de déclassement, de gens qui changent de classe, ici par le haut, vers la classe supérieure, mais dont la nouvelle position sociale n'est pas encore acquise, ce qui est source d'incertitude)
On peut supposer que la plupart des étudiants qui se trouvaient dans cette situation, sans forcément qu'ils l'aient exprimé explicitement, sans qu'ils l'aient mis en mots de manière politique, étaient conscients de ce défi qui s'imposaient à eux, et avaient au moins une forme bien spécifique de conscience politique reposant sur leurs doutes quant au futur de leur génération.
Le fait qu'ils se soient vécus collectivement comme
une génération, que leur expérience commune pouvait transcender d'autres différences sociales (de classe, d'origine, etc...) pourrait aussi être ramené à certaines circonstances socio-historiques, mais ça serait aller un peu loin que d'en discuter ici.
enfin un petit rappel qui n'a l'air de rien, mais la plupart des gens passent à côté : les jeunes, ça n'est pas que les étudiants, c'est aussi beaucoup d'ouvriers et d'employés...
Pour ce qui est des événements qui ont conduit aux... Evénements, il faudrait faire une chronologie complexe mettant en relation les microcosmes syndicaux, politiques, étudiants, internationaux... L'exhaustivité semble nécessaire ici pour rendre compte de l'imbrication de différents processus, mais ça serait assez fastidieux de le faire dans un post. Je te renverrais encore une fois au bouquin que j'ai cité.