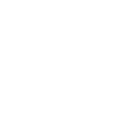Introduction: la Bulle d'Or et le sentiment d'humiliation

Rodolphe Ier (1218-1291), comte de Habsbourg avait permis à la dynastie alsacienne d'étendre son influence bien au-delà de ses limites territoriales rhénanes. L'extension du domaine comtal au nord de la Suisse actuelle lui apporta l'équilibre financier lui permettant de développer une politique germanique capable de le porter à la tête du Royaume. En s'appuyant sur ses liens avec Frédéric III de Nuremberg, héritier de la dynastie Hohenzollern, il acquit le soutien des électeurs de Saxe et de Bavière qui le portèrent sur le trône de Germanie en 1273, malgré l'opposition du Roi de Bohème, Ottokar II.
Ce dernier avait acquis au cours de son règne une très large prédominance sur le sud-est impériale, en conquérant ou s'octroyant par ses relations matrimoniales de vastes domaines en Autriche, Styrie et Carinthie. Cette expansion fut probablement considérée comme une menace pour les princes allemands de Bavière et du Tyrol qui donnèrent leur soutien plein et entier à Rodolphe dans ses premiers mouvements diplomatique en tant que Roi de Germanie.

Territoires sous l'autorité d'Ottokar II en vert
Réunissant la Diète impériale en 1274, il demanda la restitution à la couronne des territoires autrichiens acquis depuis le XIIe siècle. Ottokar refusa et fut mis au ban de l'Empire et la guerre fut déclarée. Le retournement des alliances permit à Rodolphe Ier de vaincre Ottokar en 1276 qui céda les quatre fiefs d'Autriche, de Styrie, de Carinthie et de Carniole en échange de son maintien à la tête de la Bohème et du mariage de son fils avec une des filles de Rodolphe.
Rodolphe mit à profit la fin de son règne pour pacifier les provinces nouvellement acquises et les transmettre à ses fils Albert et Rodolphe. Mais par le traité de Rheinfelden de juin 1283, Albert fut désigné unique successeur de l'héritage habsbourgeois.
Adolphe de Nassau avait entretemps ligué contre lui les électeurs qui le déposèrent en 1297. Albert fut élu en 1298 par les princes qui craignaient auparavant pour leur indépendance. Et la politique du duc d’Autriche les conforta rapidement dans leur crainte. Il tenta d’accroître ses possessions à l’est de l’Empire en récupérant la couronne de Bohème dont le dernier roi, Wenceslas III, venait de décéder sans héritier mâle, ainsi qu’en Thuringe, Misnie et Hollande. Diplomatiquement, il se rapprocha du royaume de France et de la Papauté pour être reconnu sur l’échiquier européen et valider sa politique intérieur de consolidation de l’autorité royale.
Le 1er mai 1308, Albert fut assassiné par son neveu Jean aidé de plusieurs nobles suisses que la politique autoritaire du duc avait lésés. Effrayés à l’idée que ses héritiers puissent poursuivre la politique de leur père, les électeurs du Saint-Empire se tournèrent vers Louis de Luxembourg pour prendre le trône de Germanie et récupérer à son profit la couronne de Bohème.

"La mort d'Albert Ier le 1er mai 1308", miniature tirée de la Chronique autrichienne des 95 Etats, 1479/1480
Les enfants d’Albert, Frédéric et Léopold, ne réussirent pas à poursuivre la politique de leur père. Ecrasés par les Suisses à la bataille de Morgarten en 1315, vaincus par les Bavarois en 1322 à la bataille de Mühldorf où Frédéric fut capturé par Louis IV de Bavière, ils renoncèrent finalement à la couronne et se replièrent sur leurs territoires autrichiens.
A la mort de Frédéric en 1330, Albert dirigea conjointement avec son frère Otto les fiefs habsbourgeois. Il se réconcilia avec Louis de Bavière par le traité d’Haguenau le 6 août 1330. Ce dernier lui offrit, en échange du renoncement à la couronne germanique, la Carinthie et la Styrie qui offraient richesses et accès à l’Adriatique.
Jean de Bohème accepta d’abandonner ses prétentions sur la Carinthie, par l’action diplomatique de Louis de Bavière. Libérée de la menace tchèque, l’Autriche vécut une période de paix relative et de prospérité jusqu’à l’apparition de la Peste Noire qui entraîna la mort d’un tiers de sa population et une grave crise sociale et religieuse.
Louis de Bavière avait ligué contre lui les électeurs germaniques, les princes italiens, la papauté et le Roi de France en s’engageant aux côtés des Anglais dans la guerre de Cent Ans. L’échec d’Edouard III d’Angleterre en Flandre mena l’Empire à l’échec. Le pape Clément VI, proche de Philippe VI de France, demanda l’abdication de Louis et fit élire contre lui Charles, fils de Jean de Bohème. La mort de Louis en 1347 laissa Charles seul maître du titre. Il fut couronné roi de Germanie le 6 janvier 1355 et finalement Empereur Romain Germanique le 6 janvier de la même année.
La principale décision de Charles IV de Bohème fut de relever les institutions impériales. Il convoqua le 25 novembre 1355 la Diète d’Empire afin de réorganiser le fonctionnement impérial. Le nombre d’électeurs est fixé à sept. L’Empereur est élu à la majorité et non à l’unanimité comme précédemment. L’autorité du Pape sur le couronnement est supprimée, limitant de fait les ingérences extérieures dans la prise de décision des électeurs.
Pour l’Autriche, cette décision fut lourde de conséquences. La maison de Habsbourg, qui avait crû si rapidement au cours des XIIIe et XIVe siècles, était cloisonnée aux marges de l’Empire. Charles IV de Bohème s’était attribué un titre d’électeur et avait offert à ses soutiens les six autres. Après avoir perdu la couronne germanique, l’Autriche se voyait également retirer toute possibilité décisionnelle dans le choix de l’Empereur.

Auguste Migette, Le décret de la Bulle d'Or par la Diète à Metz, vers 1850
Albert II vit cette décision de Charles IV comme une provocation qui entraîna près d’un siècle de rivalités diplomatique et militaire entre les deux voisins. Il décida alors de réorienter ses velléités de contrôle sur le sud de l’Empire et au-delà de ses frontières, tout en se dégageant de l’autorité impériale. Il engagea également une politique de rapprochement avec les électeurs effrayés de l’accroissement du pouvoir de la Bohème et pouvoir combattre diplomatiquement au sein de la Diète son rival tchèque.

Domaines du Saint-Empire, 1273-1378. En orange les domaines des Habsbourg.

- L'émergence des Habsbourgs
Rodolphe Ier (1218-1291), comte de Habsbourg avait permis à la dynastie alsacienne d'étendre son influence bien au-delà de ses limites territoriales rhénanes. L'extension du domaine comtal au nord de la Suisse actuelle lui apporta l'équilibre financier lui permettant de développer une politique germanique capable de le porter à la tête du Royaume. En s'appuyant sur ses liens avec Frédéric III de Nuremberg, héritier de la dynastie Hohenzollern, il acquit le soutien des électeurs de Saxe et de Bavière qui le portèrent sur le trône de Germanie en 1273, malgré l'opposition du Roi de Bohème, Ottokar II.
Ce dernier avait acquis au cours de son règne une très large prédominance sur le sud-est impériale, en conquérant ou s'octroyant par ses relations matrimoniales de vastes domaines en Autriche, Styrie et Carinthie. Cette expansion fut probablement considérée comme une menace pour les princes allemands de Bavière et du Tyrol qui donnèrent leur soutien plein et entier à Rodolphe dans ses premiers mouvements diplomatique en tant que Roi de Germanie.

Territoires sous l'autorité d'Ottokar II en vert
Réunissant la Diète impériale en 1274, il demanda la restitution à la couronne des territoires autrichiens acquis depuis le XIIe siècle. Ottokar refusa et fut mis au ban de l'Empire et la guerre fut déclarée. Le retournement des alliances permit à Rodolphe Ier de vaincre Ottokar en 1276 qui céda les quatre fiefs d'Autriche, de Styrie, de Carinthie et de Carniole en échange de son maintien à la tête de la Bohème et du mariage de son fils avec une des filles de Rodolphe.
Rodolphe mit à profit la fin de son règne pour pacifier les provinces nouvellement acquises et les transmettre à ses fils Albert et Rodolphe. Mais par le traité de Rheinfelden de juin 1283, Albert fut désigné unique successeur de l'héritage habsbourgeois.
- Échec et renoncement
Adolphe de Nassau avait entretemps ligué contre lui les électeurs qui le déposèrent en 1297. Albert fut élu en 1298 par les princes qui craignaient auparavant pour leur indépendance. Et la politique du duc d’Autriche les conforta rapidement dans leur crainte. Il tenta d’accroître ses possessions à l’est de l’Empire en récupérant la couronne de Bohème dont le dernier roi, Wenceslas III, venait de décéder sans héritier mâle, ainsi qu’en Thuringe, Misnie et Hollande. Diplomatiquement, il se rapprocha du royaume de France et de la Papauté pour être reconnu sur l’échiquier européen et valider sa politique intérieur de consolidation de l’autorité royale.
Le 1er mai 1308, Albert fut assassiné par son neveu Jean aidé de plusieurs nobles suisses que la politique autoritaire du duc avait lésés. Effrayés à l’idée que ses héritiers puissent poursuivre la politique de leur père, les électeurs du Saint-Empire se tournèrent vers Louis de Luxembourg pour prendre le trône de Germanie et récupérer à son profit la couronne de Bohème.

"La mort d'Albert Ier le 1er mai 1308", miniature tirée de la Chronique autrichienne des 95 Etats, 1479/1480
Les enfants d’Albert, Frédéric et Léopold, ne réussirent pas à poursuivre la politique de leur père. Ecrasés par les Suisses à la bataille de Morgarten en 1315, vaincus par les Bavarois en 1322 à la bataille de Mühldorf où Frédéric fut capturé par Louis IV de Bavière, ils renoncèrent finalement à la couronne et se replièrent sur leurs territoires autrichiens.
- Albert II, consolidation et humiliation
A la mort de Frédéric en 1330, Albert dirigea conjointement avec son frère Otto les fiefs habsbourgeois. Il se réconcilia avec Louis de Bavière par le traité d’Haguenau le 6 août 1330. Ce dernier lui offrit, en échange du renoncement à la couronne germanique, la Carinthie et la Styrie qui offraient richesses et accès à l’Adriatique.
Jean de Bohème accepta d’abandonner ses prétentions sur la Carinthie, par l’action diplomatique de Louis de Bavière. Libérée de la menace tchèque, l’Autriche vécut une période de paix relative et de prospérité jusqu’à l’apparition de la Peste Noire qui entraîna la mort d’un tiers de sa population et une grave crise sociale et religieuse.
Louis de Bavière avait ligué contre lui les électeurs germaniques, les princes italiens, la papauté et le Roi de France en s’engageant aux côtés des Anglais dans la guerre de Cent Ans. L’échec d’Edouard III d’Angleterre en Flandre mena l’Empire à l’échec. Le pape Clément VI, proche de Philippe VI de France, demanda l’abdication de Louis et fit élire contre lui Charles, fils de Jean de Bohème. La mort de Louis en 1347 laissa Charles seul maître du titre. Il fut couronné roi de Germanie le 6 janvier 1355 et finalement Empereur Romain Germanique le 6 janvier de la même année.
La principale décision de Charles IV de Bohème fut de relever les institutions impériales. Il convoqua le 25 novembre 1355 la Diète d’Empire afin de réorganiser le fonctionnement impérial. Le nombre d’électeurs est fixé à sept. L’Empereur est élu à la majorité et non à l’unanimité comme précédemment. L’autorité du Pape sur le couronnement est supprimée, limitant de fait les ingérences extérieures dans la prise de décision des électeurs.
Pour l’Autriche, cette décision fut lourde de conséquences. La maison de Habsbourg, qui avait crû si rapidement au cours des XIIIe et XIVe siècles, était cloisonnée aux marges de l’Empire. Charles IV de Bohème s’était attribué un titre d’électeur et avait offert à ses soutiens les six autres. Après avoir perdu la couronne germanique, l’Autriche se voyait également retirer toute possibilité décisionnelle dans le choix de l’Empereur.

Auguste Migette, Le décret de la Bulle d'Or par la Diète à Metz, vers 1850
Albert II vit cette décision de Charles IV comme une provocation qui entraîna près d’un siècle de rivalités diplomatique et militaire entre les deux voisins. Il décida alors de réorienter ses velléités de contrôle sur le sud de l’Empire et au-delà de ses frontières, tout en se dégageant de l’autorité impériale. Il engagea également une politique de rapprochement avec les électeurs effrayés de l’accroissement du pouvoir de la Bohème et pouvoir combattre diplomatiquement au sein de la Diète son rival tchèque.

Domaines du Saint-Empire, 1273-1378. En orange les domaines des Habsbourg.
- 1