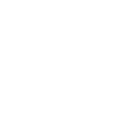Une civilisation vieille de plus de 5 000 ans sort de terre en Iran
LE MONDE | 02.10.03 | 14h33 • MIS A JOUR LE 02.10.03 | 17h02
Entre 2001 et 2002, des milliers d'habitants de la région de Jiroft ont pillé plusieurs cimetières très anciens sans savoir qu'ils exhumaient un foyer culturel et artistique inconnu des archéologues, qui pourrait être l'équivalent de la Mésopotamie à la même époque.
De manière caricaturale, la profession d'archéologue se résume souvent pour le public à une chasse au bel objet alors qu'elle est avant tout une quête d'histoire. Mais il ne faut pas bouder son plaisir lorsque des trésors surgissent de terre. Ainsi, quand l'archéologue franco-iranien Youssef Madjidzadeh se retrouva, en 2002, dans la cour de la prison de Kerman (Iran), en présence d'une quantité d'objets issus de fouilles sauvages et saisis par la douane locale, il manqua se sentir mal.
" Il ne fut pas le seul, raconte Jean Perrot, ancien directeur de recherches au CNRS et spécialiste de l'Iran ancien. Lorsque mes collègues ont vu ce matériel, certains ont eu une poussée d'adrénaline et j'ai bien cru qu'il faudrait appeler le SAMU..."
Devant les yeux de tous ces chercheurs, apparaissait l'expression d'un foyer culturel et artistique vieux de plus de cinq mille ans, dont l'existence n'avait jusqu'alors pas été pressentie. Certes, quelques vestiges avaient été retrouvés çà et là tout autour du golfe Persique, mais sans que l'on puisse deviner leur origine.
Les très nombreux objets dévoilés dans le numéro d'octobre des Dossiers d'archéologie et présentés à Paris par Youssef Madjidzadeh et Jean Perrot proviennent de la région de Jiroft, située dans la province de Kerman, au sud-est de l'Iran. Entourée sur trois côtés par des montagnes culminant à plus de 4 000 mètres, cette cuvette isolée constitue un no man's land archéologique. Mais il ne s'agit pas d'un désert humain. En 2001, à la suite d'une inondation, un des habitants découvrit, probablement dans une tombe éventrée par le passage de l'eau, des vases en chlorite et s'aperçut vite du bénéfice qu'il pouvait en tirer.
PILLAGE MASSIF
Cela donna le coup d'envoi d'une incroyable et gigantesque opération de fouilles clandestines, que décrit Youssef Madjidzadeh : "Des milliers de personnes ont participé au saccage, à la recherche de trésors. Ils fouillaient de l'aube au coucher du soleil. Un carré de 6 × 6 mètres était dévolu à chaque famille. Par souci d'équité, une parcelle de taille identique était également accordée à des groupes de six veuves. Ce pillage massif et de longue durée a porté surtout sur des cimetières où des offrandes funéraires avaient été déposées en grand nombre, parfois jusqu'à soixante objets dans une tombe. Les secteurs résidentiels ont échappé à la destruction."
Pendant des mois, des milliers de vestiges furent exhumés sur ce mode sauvage, sans qu'il soit possible d'en effectuer un décompte précis. Au même moment, de nombreuses antiquités moyen-orientales inondaient les salles des ventes européennes, américaines et asiatiques... Il fallut attendre le début de 2002 pour que les autorités iraniennes réagissent, arrêtent des contrebandiers et des fonctionnaires locaux coupables de laxisme et confisquent environ deux mille objets.
L'inventaire du butin pouvait commencer. Il était constitué de vases, de godets et de coupes en chlorite - pierre tendre facile à sculpter - portant en relief de nombreuses décorations, les artistes d'alors répugnant visiblement à laisser des vides. Les plus belles pièces étaient en général incrustées de pierres semi-précieuses, dont la plupart ont disparu.
On y voit tout un monde : des villes fortifiées entourant des bâtiments assez élaborés, différentes espèces de végétaux, mais également nombre de scènes animées, des zébus, des chèvres, d'étranges têtes de femmes émergeant de vases, des serpents enlacés, seuls ou se battant contre des panthères, des combats de fauves, mais aussi la lutte de créatures fantastiques, hybrides d'hommes et de lions, de scorpions et de taureaux.
Pour Jean Perrot, cette récolte d'objets richement décorés est une aubaine : "Nous disposons d'une iconographie homogène, utilisant le même "vocabulaire" et la même "syntaxe". Elle nous livre le reflet du monde d'alors, du milieu naturel et des paysages dans lesquels vivaient ces gens il y a cinq mille ans, ainsi que le reflet de leur monde intérieur, de leur imaginaire, de leurs préoccupations, de leur peur de la mort. Ce qui permet de faire un point sur le stade qu'avait atteint la pensée humaine au tournant du IVe et du IIIe millénaire avant Jésus-Christ."
"L'IDÉE DU DIVIN"
Un des vases sculptés s'avère particulièrement frappant : au-dessus d'une scène pastorale prenant pour décor un paysage de torrents et de montagnes, un homme, derrière lequel se trouvent le Soleil et la Lune, tient, les bras levés, ce qui pourrait être un arc-en-ciel ou une représentation de la voûte céleste. Comme le fait remarquer Jean Perrot, "on dirait qu'il est à la recherche d'un principe supérieur. L'étude de l'iconographie de ces objets montre que cette notion de principe supérieur est en train de se concrétiser. L'idée du divin est déjà présente, mais elle ne se traduit pas encore sous figure humaine. Cela ne viendra qu'après, en Mésopotamie".
Selon le spécialiste de l'ancien Iran Carl Lamberg-Karlovsky, professeur à l'université Harvard, la découverte des vestiges archéologiques de la région de Jiroft constitue un événement considérable qui "remet en cause notre concept fondamental des origines de la civilisation du Moyen-Orient". "Dans une région qu'on ne croyait habitée que par des nomades poussant des moutons devant eux,poursuit Jean Perrot, on a une civilisation évoluée, un foyer rayonnant au moins égal sinon supérieur à ce que l'on trouve en Mésopotamie au même moment."
La première campagne de fouilles officielles, menée par Youssef Madjidzadeh, a eu lieu en janvier et février, époque de l'année où les conditions météorologiques sont le mieux adaptées au travail sur le terrain. Parmi les quelque quatre-vingts sites désormais répertoriés, les chercheurs ont privilégié non pas les cimetières mais les restes d'une ville entourée de puissants remparts. De nombreux vestiges et structures ont été mis au jour, mais ce n'est que le début d'une longue exploration.
Devant l'ampleur de la tâche, le professeur Madjidzadeh soupire : "On aura peut-être besoin de cinquante ans pour finir les fouilles. Ou peut-être plus... Je sais que nous avons devant nous l'équivalent de la Mésopotamie, et ce sera un travail très dur. J'ai donc proposé à des équipes internationales de collaborer avec nous." Les Américains de l'université de Pennsylvanie sont très intéressés. En revanche, la Maison de l'archéologie et de l'ethnologie de l'université de Nanterre (Paris-X), contactée, n'a toujours pas donné de réponse...
Pierre Barthélémy
• ARTICLE PARU DANS L'EDITION DU 03.10.03
LE MONDE | 02.10.03 | 14h33 • MIS A JOUR LE 02.10.03 | 17h02
Entre 2001 et 2002, des milliers d'habitants de la région de Jiroft ont pillé plusieurs cimetières très anciens sans savoir qu'ils exhumaient un foyer culturel et artistique inconnu des archéologues, qui pourrait être l'équivalent de la Mésopotamie à la même époque.
De manière caricaturale, la profession d'archéologue se résume souvent pour le public à une chasse au bel objet alors qu'elle est avant tout une quête d'histoire. Mais il ne faut pas bouder son plaisir lorsque des trésors surgissent de terre. Ainsi, quand l'archéologue franco-iranien Youssef Madjidzadeh se retrouva, en 2002, dans la cour de la prison de Kerman (Iran), en présence d'une quantité d'objets issus de fouilles sauvages et saisis par la douane locale, il manqua se sentir mal.
" Il ne fut pas le seul, raconte Jean Perrot, ancien directeur de recherches au CNRS et spécialiste de l'Iran ancien. Lorsque mes collègues ont vu ce matériel, certains ont eu une poussée d'adrénaline et j'ai bien cru qu'il faudrait appeler le SAMU..."
Devant les yeux de tous ces chercheurs, apparaissait l'expression d'un foyer culturel et artistique vieux de plus de cinq mille ans, dont l'existence n'avait jusqu'alors pas été pressentie. Certes, quelques vestiges avaient été retrouvés çà et là tout autour du golfe Persique, mais sans que l'on puisse deviner leur origine.
Les très nombreux objets dévoilés dans le numéro d'octobre des Dossiers d'archéologie et présentés à Paris par Youssef Madjidzadeh et Jean Perrot proviennent de la région de Jiroft, située dans la province de Kerman, au sud-est de l'Iran. Entourée sur trois côtés par des montagnes culminant à plus de 4 000 mètres, cette cuvette isolée constitue un no man's land archéologique. Mais il ne s'agit pas d'un désert humain. En 2001, à la suite d'une inondation, un des habitants découvrit, probablement dans une tombe éventrée par le passage de l'eau, des vases en chlorite et s'aperçut vite du bénéfice qu'il pouvait en tirer.
PILLAGE MASSIF
Cela donna le coup d'envoi d'une incroyable et gigantesque opération de fouilles clandestines, que décrit Youssef Madjidzadeh : "Des milliers de personnes ont participé au saccage, à la recherche de trésors. Ils fouillaient de l'aube au coucher du soleil. Un carré de 6 × 6 mètres était dévolu à chaque famille. Par souci d'équité, une parcelle de taille identique était également accordée à des groupes de six veuves. Ce pillage massif et de longue durée a porté surtout sur des cimetières où des offrandes funéraires avaient été déposées en grand nombre, parfois jusqu'à soixante objets dans une tombe. Les secteurs résidentiels ont échappé à la destruction."
Pendant des mois, des milliers de vestiges furent exhumés sur ce mode sauvage, sans qu'il soit possible d'en effectuer un décompte précis. Au même moment, de nombreuses antiquités moyen-orientales inondaient les salles des ventes européennes, américaines et asiatiques... Il fallut attendre le début de 2002 pour que les autorités iraniennes réagissent, arrêtent des contrebandiers et des fonctionnaires locaux coupables de laxisme et confisquent environ deux mille objets.
L'inventaire du butin pouvait commencer. Il était constitué de vases, de godets et de coupes en chlorite - pierre tendre facile à sculpter - portant en relief de nombreuses décorations, les artistes d'alors répugnant visiblement à laisser des vides. Les plus belles pièces étaient en général incrustées de pierres semi-précieuses, dont la plupart ont disparu.
On y voit tout un monde : des villes fortifiées entourant des bâtiments assez élaborés, différentes espèces de végétaux, mais également nombre de scènes animées, des zébus, des chèvres, d'étranges têtes de femmes émergeant de vases, des serpents enlacés, seuls ou se battant contre des panthères, des combats de fauves, mais aussi la lutte de créatures fantastiques, hybrides d'hommes et de lions, de scorpions et de taureaux.
Pour Jean Perrot, cette récolte d'objets richement décorés est une aubaine : "Nous disposons d'une iconographie homogène, utilisant le même "vocabulaire" et la même "syntaxe". Elle nous livre le reflet du monde d'alors, du milieu naturel et des paysages dans lesquels vivaient ces gens il y a cinq mille ans, ainsi que le reflet de leur monde intérieur, de leur imaginaire, de leurs préoccupations, de leur peur de la mort. Ce qui permet de faire un point sur le stade qu'avait atteint la pensée humaine au tournant du IVe et du IIIe millénaire avant Jésus-Christ."
"L'IDÉE DU DIVIN"
Un des vases sculptés s'avère particulièrement frappant : au-dessus d'une scène pastorale prenant pour décor un paysage de torrents et de montagnes, un homme, derrière lequel se trouvent le Soleil et la Lune, tient, les bras levés, ce qui pourrait être un arc-en-ciel ou une représentation de la voûte céleste. Comme le fait remarquer Jean Perrot, "on dirait qu'il est à la recherche d'un principe supérieur. L'étude de l'iconographie de ces objets montre que cette notion de principe supérieur est en train de se concrétiser. L'idée du divin est déjà présente, mais elle ne se traduit pas encore sous figure humaine. Cela ne viendra qu'après, en Mésopotamie".
Selon le spécialiste de l'ancien Iran Carl Lamberg-Karlovsky, professeur à l'université Harvard, la découverte des vestiges archéologiques de la région de Jiroft constitue un événement considérable qui "remet en cause notre concept fondamental des origines de la civilisation du Moyen-Orient". "Dans une région qu'on ne croyait habitée que par des nomades poussant des moutons devant eux,poursuit Jean Perrot, on a une civilisation évoluée, un foyer rayonnant au moins égal sinon supérieur à ce que l'on trouve en Mésopotamie au même moment."
La première campagne de fouilles officielles, menée par Youssef Madjidzadeh, a eu lieu en janvier et février, époque de l'année où les conditions météorologiques sont le mieux adaptées au travail sur le terrain. Parmi les quelque quatre-vingts sites désormais répertoriés, les chercheurs ont privilégié non pas les cimetières mais les restes d'une ville entourée de puissants remparts. De nombreux vestiges et structures ont été mis au jour, mais ce n'est que le début d'une longue exploration.
Devant l'ampleur de la tâche, le professeur Madjidzadeh soupire : "On aura peut-être besoin de cinquante ans pour finir les fouilles. Ou peut-être plus... Je sais que nous avons devant nous l'équivalent de la Mésopotamie, et ce sera un travail très dur. J'ai donc proposé à des équipes internationales de collaborer avec nous." Les Américains de l'université de Pennsylvanie sont très intéressés. En revanche, la Maison de l'archéologie et de l'ethnologie de l'université de Nanterre (Paris-X), contactée, n'a toujours pas donné de réponse...
Pierre Barthélémy
• ARTICLE PARU DANS L'EDITION DU 03.10.03